Avec l’aimable autorisation de M éditeur
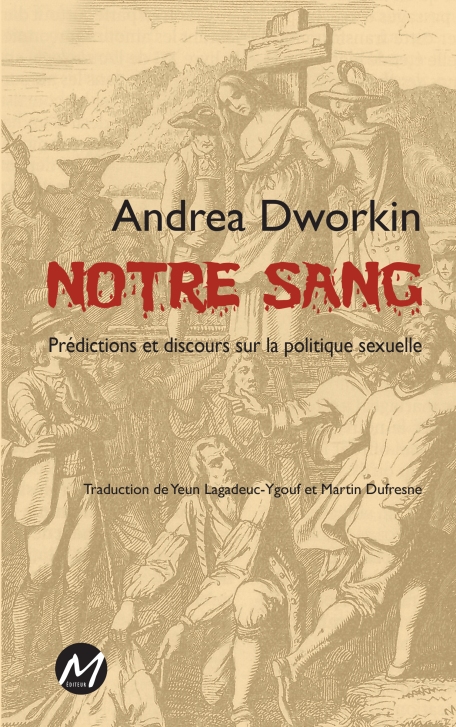 Notre sang est un livre qui a germé d’une situation, la situation étant que je n’arrivais pas à faire publier mon travail. J’ai donc pris la parole en public – non pas avec l’étalage improvisé de pensées ou l’effusion de sentiments, mais avec une prose façonnée pour informer, persuader, perturber, provoquer la reconnaissance, autoriser la rage. Je me suis dit que si les éditeurs ne publiaient pas mes travaux, je les contournerais complètement. J’ai décidé d’écrire directement aux gens, pour ma propre voix. J’ai commencé à écrire de cette façon parce que je n’avais pas d’autre choix : je ne voyais pas d’autre moyen de survivre en tant qu’écrivaine. J’étais persuadée que c’était l’establishment de l’édition – les rédactrices en chef timides et impuissantes, la superstructure des hommes qui prennent les vraies décisions, les critiques misogynes – qui s’interposaient entre moi et un public composé surtout de femmes que je savais être là. L’establishment de l’édition formait une formidable digue, et mon plan était de la contourner à la nage. En avril 1974, mon premier livre de théorie féministe, Woman Hating, a été publié. Avant sa publication, j’avais eu des difficultés. On m’avait proposé de remplir pour des magazines des missions qui étaient écœurantes. On m’avait proposé beaucoup d’argent pour écrire des articles qu’un éditeur m’avait déjà décrits dans les moindres détails. Il devait s’agir de femmes ou de sexe ou de drogues. Ces articles étaient stupides et remplis de mensonges. Par exemple, on m’a offert 1 500 dollars pour écrire un article à propos de la consommation de barbituriques et d’amphétamines par les femmes des banlieues. Je devais dire que cet usage de drogues constituait un acte de rébellion hédoniste contre les conventions ennuyeuses de la vie stérile de ménagère, que les femmes utilisaient ces drogues pour s’éclater, faire de l’échangisme et accéder à un merveilleux nouveau style de vie. J’ai dit à l’éditeur que je soupçonnais les femmes d’utiliser les amphétamines pour passer au travers de journées misérables et les barbituriques pour passer au travers de nuits misérables. J’ai suggéré, aimablement je crois, que j’aille demander aux femmes qui les utilisent pourquoi elles le faisaient. On m’a rétorqué que l’article dirait à quel point c’était amusant. J’ai refusé la mission. Cela ressemble à une amusante rébellion de dire à l’establishment d’aller se faire foutre avec ses poignées de dollars, mais quand on est très pauvre, comme je l’étais, ce n’est pas drôle. C’est plutôt profondément déchirant. Six ans plus tard, j’ai finalement gagné la moitié du même montant pour un article de magazine, c’est la somme la plus élevée que j’aie jamais reçue pour un article. J’avais eu l’occasion de jouer le jeu et j’avais refusé. J’étais trop naïve pour savoir que l’écriture sur commande est le seul jeu payant en ville. Je croyais dans « la littérature », « les principes », « la politique » et « le pouvoir de la grande écriture pour changer les vies ». Quand j’ai refusé de faire cet article et d’autres, je l’ai fait avec une indignation immense. L’indignation m’a désignée comme une sauvageonne, une garce, une réputation qui se renforça lors de conflits éditoriaux au sujet du contenu de La haine des femmes, une réputation qui m’a hantée et blessée : pas blessée dans mes sentiments, mais blessée dans ma capacité à vivre de mon travail. Je ne suis en fait pas une « dame », pas une « dame écrivaine », pas une « douce jeune chose ». Quelle femme l’est ? Mon éthique, ma politique et mon style ont fusionné pour faire de moi une intouchable. Les filles sont censées être invitantes et touchables, à la surface ou plus bas.
Notre sang est un livre qui a germé d’une situation, la situation étant que je n’arrivais pas à faire publier mon travail. J’ai donc pris la parole en public – non pas avec l’étalage improvisé de pensées ou l’effusion de sentiments, mais avec une prose façonnée pour informer, persuader, perturber, provoquer la reconnaissance, autoriser la rage. Je me suis dit que si les éditeurs ne publiaient pas mes travaux, je les contournerais complètement. J’ai décidé d’écrire directement aux gens, pour ma propre voix. J’ai commencé à écrire de cette façon parce que je n’avais pas d’autre choix : je ne voyais pas d’autre moyen de survivre en tant qu’écrivaine. J’étais persuadée que c’était l’establishment de l’édition – les rédactrices en chef timides et impuissantes, la superstructure des hommes qui prennent les vraies décisions, les critiques misogynes – qui s’interposaient entre moi et un public composé surtout de femmes que je savais être là. L’establishment de l’édition formait une formidable digue, et mon plan était de la contourner à la nage. En avril 1974, mon premier livre de théorie féministe, Woman Hating, a été publié. Avant sa publication, j’avais eu des difficultés. On m’avait proposé de remplir pour des magazines des missions qui étaient écœurantes. On m’avait proposé beaucoup d’argent pour écrire des articles qu’un éditeur m’avait déjà décrits dans les moindres détails. Il devait s’agir de femmes ou de sexe ou de drogues. Ces articles étaient stupides et remplis de mensonges. Par exemple, on m’a offert 1 500 dollars pour écrire un article à propos de la consommation de barbituriques et d’amphétamines par les femmes des banlieues. Je devais dire que cet usage de drogues constituait un acte de rébellion hédoniste contre les conventions ennuyeuses de la vie stérile de ménagère, que les femmes utilisaient ces drogues pour s’éclater, faire de l’échangisme et accéder à un merveilleux nouveau style de vie. J’ai dit à l’éditeur que je soupçonnais les femmes d’utiliser les amphétamines pour passer au travers de journées misérables et les barbituriques pour passer au travers de nuits misérables. J’ai suggéré, aimablement je crois, que j’aille demander aux femmes qui les utilisent pourquoi elles le faisaient. On m’a rétorqué que l’article dirait à quel point c’était amusant. J’ai refusé la mission. Cela ressemble à une amusante rébellion de dire à l’establishment d’aller se faire foutre avec ses poignées de dollars, mais quand on est très pauvre, comme je l’étais, ce n’est pas drôle. C’est plutôt profondément déchirant. Six ans plus tard, j’ai finalement gagné la moitié du même montant pour un article de magazine, c’est la somme la plus élevée que j’aie jamais reçue pour un article. J’avais eu l’occasion de jouer le jeu et j’avais refusé. J’étais trop naïve pour savoir que l’écriture sur commande est le seul jeu payant en ville. Je croyais dans « la littérature », « les principes », « la politique » et « le pouvoir de la grande écriture pour changer les vies ». Quand j’ai refusé de faire cet article et d’autres, je l’ai fait avec une indignation immense. L’indignation m’a désignée comme une sauvageonne, une garce, une réputation qui se renforça lors de conflits éditoriaux au sujet du contenu de La haine des femmes, une réputation qui m’a hantée et blessée : pas blessée dans mes sentiments, mais blessée dans ma capacité à vivre de mon travail. Je ne suis en fait pas une « dame », pas une « dame écrivaine », pas une « douce jeune chose ». Quelle femme l’est ? Mon éthique, ma politique et mon style ont fusionné pour faire de moi une intouchable. Les filles sont censées être invitantes et touchables, à la surface ou plus bas.
Je pensais que la publication de La haine des femmes m’installerait en tant qu’écrivaine au talent reconnu et que j’aurais alors la possibilité de publier des travaux sérieux dans des magazines non moins sérieux. J’avais tort. La publication de La haine des femmes, à propos de laquelle je jubilais, a été le début d’un déclin qui s’est poursuivi jusqu’en 1981, à la publication de Pornography : Men Possessing Women. L’éditeur de La haine des femmes n’aimait pas le livre : je minimise ici considérablement. Je n’étais pas censée dire, par exemple, « les femmes sont violées ». J’étais censée dire : « Les femmes aux yeux verts avec une jambe plus longue que l’autre, les cheveux entre les dents, munies de caniches, avec un goût pour les légumes frits sont violées occasionnellement le vendredi par des personnes. » C’était dur. Je croyais avoir le droit de dire ce que je voulais. Mes souhaits n’étaient pas particulièrement fantaisistes : mes sources étaient l’histoire, les faits, l’expérience. J’avais été élevée dans une tradition de littérature quasi exclusivement masculine, et cette tradition, quels qu’en soient les défauts, n’enseignait pas la timidité ou la peur : les écrivains que j’admirais étaient directs et pas particulièrement polis. Je ne comprenais pas que – même en tant qu’écrivaine – j’étais censée être délicate, fragile, intuitive, personnelle, introspective. Je voulais prétendre au monde public de l’action, pas au monde privé des sentiments. Mon ambition était perçue comme mégalomane – pas dans la bonne sphère, démente par définition. Oui, j’étais naïve. Je n’avais pas appris où était ma place. Je savais contre quoi je me rebellais dans la vie, mais je ne savais pas que la littérature avait les mêmes limites désolantes, les mêmes règles absurdes, les mêmes proscriptions cruelles [1]. C’était assez facile de me gérer : j’étais une salope. Et mon livre a été saboté. L’éditeur a simplement refusé d’honorer ses commandes. Les libraires voulaient le livre, mais ne pouvaient pas l’obtenir. Les critiques l’ont ignoré, me condamnant à l’invisibilité, à la pauvreté et à l’échec. Le premier discours reproduit dans Notre sang (« Le féminisme, l’art et ma mère Sylvia ») a été écrit avant la publication deLa haine des femmes et témoigne du profond optimisme que je ressentais à ce moment-là. En octobre, au moment du deuxième discours de Notre sang (« Renoncer à l’égalité sexuelle » [2]), je savais que la partie serait rude, mais je ne savais pas encore à quel point elle le serait.
J’y ai parlé après trois heures d’interventions personnelles sur le thème du sexe : des femmes parlant de leurs expériences, de leurs sentiments, de leurs valeurs sexuelles. Il y avait 1 100 femmes dans l’auditoire ; aucun homme n’était présent. Quand j’ai eu terminé, les 1 100 femmes se sont levées. Les femmes pleuraient, tremblaient et criaient. Les applaudissements ont duré près de dix minutes. Ce fut l’une des plus étonnantes expériences de ma vie. Beaucoup des discours que je donnais étaient ovationnés et ce n’était pas le premier, mais je n’avais jamais parlé à un auditoire aussi grand, et ce que j’ai dit contredisait assez fermement beaucoup de ce qui avait été dit avant que je parle. La réponse a donc été étonnante et cela m’a submergée. La couverture du discours m’a également bouleversée. Un hebdomadaire new-yorkais a publié deux calomnies. L’une provenait d’une femme qui au moins avait été présente. Elle suggéra que les hommes pourraient mourir de frustration sexuelle si j’étais prise au sérieux. L’autre provenait d’un homme qui n’était pas présent ; il avait entendu des femmes parler dans le hall. Il « voyait rouge ». Il ne pouvait pas supporter la possibilité qu’« une femme puisse considérer comme masochiste son [propre] consentement devant les moyens de ma libération [la sienne] ». C’était le « danger que représente l’idéologie de Dworkin ». Eh bien, oui, mais ces deux personnes avaient vicieusement déformé ce que j’avais vraiment dit. De nombreuses femmes, dont certaines écrivaines assez célèbres, ont rédigé des lettres déplorant l’absence d’équité et d’honnêteté de ces deux textes. Aucune de ces lettres n’a été publiée. Au lieu de cela, des lettres d’hommes absents à la conférence l’ont été ; l’un d’eux a comparé mon discours à la Solution finale d’Hitler. J’avais utilisé les mots « pénis » et « flasque » l’un après l’autre : « Pénis flasque. » Un tel usage a offensé ; il a offensé si profondément que cela justifiait une comparaison avec un génocide accompli. Rien de ce que j’avais dit au sujet des femmes n’a été mentionné, même pas au passage. Le discours parlait des femmes. L’hebdomadaire en question n’a depuis jamais publié un de mes articles ou recensé un de mes livres ou couvert un de mes discours (même si certains de mes discours étaient des événements importants à New York) [3]. Le genre de fureur exprimé dans ces deux articles a simplement dégoûté l’establishment de l’édition et mon travail a été emmuré. Des auditoires de tout le pays, pour la plupart composés de femmes et d’hommes, continuaient à m’ovationner, mais les publications dont on pourrait attendre de l’intérêt pour une écrivaine politique comme moi, ou pour un phénomène comme ces discours, ont refusé de reconnaître mon existence. Il y eut deux exceptions notables, bien qu’occasionnelles : les magazines Ms et Mother Jones. Dans les années qui ont suivi la publication de La haine des femmes, le livre a commencé à être considéré comme un classique féministe. Le caractère honorifique de cette réputation ne sera apparent qu’à celleux qui valorisent la Défense des droits de la femme de Mary Wollstonecraft, ou The Woman’s Bible d’Elizabeth Cady Stanton. C’était un grand honneur. Les féministes ont été seules responsables de la survie de La haine des femmes. Des féministes ont occupé les bureaux de la maison d’édition pour exiger que le livre soit réimprimé. Phyllis Chesler a contacté des écrivaines féministes de renom dans tout le pays pour leur demander des déclarations écrites de soutien au livre. Ces écrivaines ont répondu avec une générosité étonnante. Les journaux féministes ont rendu publique la suppression du livre. Les féministes qui travaillaient dans des librairies ont récupéré des exemplaires du livre dans les entrepôts des distributeurs et elles ont écrit encore et encore à l’éditeur pour réclamer le livre. Des programmes d’études féministes ont commencé à l’utiliser. Les femmes se passaient le livre de main en main, achetaient un deuxième exemplaire et un troisième et un quatrième pour l’offrir à des amies chaque fois qu’elles arrivaient à le trouver. Même si l’éditeur de La haine des femmes m’avait dit qu’il était « médiocre », la pression a finalement abouti à une réédition en poche en 1976 : 2 500 exemplaires restants non reliés ont été brochés et distribués, plus ou moins. Les problèmes de distribution ont continué, et les librairies, qui disaient vendre le livre régulièrement quand elles l’avaient en stock, ont dû attendre des mois pour que leurs commandes soient honorées. La haine des femmes en est maintenant à sa cinquième impression en livre de poche. Si le livre n’est pas un énième chapitre égaré de la littérature féminine, c’est uniquement parce que les féministes ont refusé de l’abandonner. D’une certaine manière, cette histoire est encourageante, car elle montre ce que l’activisme peut accomplir, malgré la ringardise du monde de l’édition amérikaine.
Cependant, je n’avais nulle part où aller, aucun débouché pour continuer en tant qu’écrivaine. Alors j’ai pris la route – vers des groupes de femmes qui passaient un chapeau pour moi à la fin de mon discours, vers des lycées où des étudiantes féministes se démenaient pour me trouver une centaine de dollars, vers des conférences où des femmes vendaient des t-shirts pour me payer. Je passais des semaines ou des mois à écrire une conférence. Je faisais de longs trajets ennuyeux en bus pour faire ce qui semblait n’être qu’une soirée de travail et je dormais là où il y avait une chambre. Étant insomniaque, je ne dormais pas beaucoup. Les femmes partageaient leur maison, leur nourriture, leurs cœurs avec moi, et je rencontrais des femmes dans chacune des circonstances, des femmes gentilles et des femmes hostiles, des femmes courageuses et des femmes terrifiées. Et les femmes que je rencontrais avaient subi tous les crimes, toutes les indignités : et j’écoutais. « L’atrocité du viol et le gars d’à côté » (texte publié dans cet ouvrage) a toujours suscité les mêmes réactions : j’ai entendu décrire viol après viol ; la vie de femmes défilait devant moi, viol après viol ; des femmes qui avaient été violées chez elles, dans des voitures, sur des plages, dans des ruelles, dans des salles de cours, par un homme, par deux hommes, par cinq hommes, par huit hommes, frappées, droguées, poignardées, lacérées, des femmes qui étaient en train de dormir, des femmes qui étaient avec leurs enfants, des femmes qui étaient sorties faire une promenade ou faire les courses ou aller à l’école ou en revenaient ou qui travaillaient dans leurs bureaux ou dans des usines ou des entrepôts, des jeunes femmes, des filles, des vieilles femmes, des femmes maigres, des femmes grosses, des femmes au foyer, des secrétaires, des prostituées, des enseignantes, des étudiantes. Je ne pouvais tout simplement pas endurer cela. Alors j’ai arrêté de livrer ce discours. Je pensais que j’en mourrais. J’ai appris ce que je devais savoir et plus encore que ce que je pouvais en supporter.
Ma vie sur la route était un mélange épuisant de bon et de mauvais, de ridicule et de sublime. Un exemple assez typique : j’ai donné le dernier discours de Notre sang (« La cause première », mon préféré) le soir de mon vingt-neuvième anniversaire. Je l’avais écrit comme un cadeau d’anniversaire pour moi-même. La conférence était chapeautée par un collectif politique basé à Boston. Les membres étaient censé·es me fournir le transport et le logement et, parce que c’était mon anniversaire, je voulais que ma famille, mon ami et notre chien, soient avec moi. J’avais proposé de venir une autre fois, mais iels me voulaient ce jour-là – en famille. Un membre du collectif s’est rendu à New York pour nous prendre et nous ramener à Boston, malgré l’orage le plus terrible que j’aie jamais vu. Les autres voitures sur la route étaient de vagues éclairs de lumière rouge ici et là. Le chauffeur était épuisé, on y voyait à peine ; et le chauffeur n’aimait pas mes opinions politiques. Il n’arrêtait pas de me poser des questions sur différentes théories psychanalytiques, dont je n’avais pas le bon sens d’en aimer une. Je n’arrêtais pas d’essayer de changer de sujet – il insistait toujours pour que je lui dise ce que je pensais d’untel ou d’untel – et chaque fois que j’étais acculée au point de devoir répondre, il forçait du pied sur l’accélérateur. J’ai cru que nous allions y rester, en raison de l’épuisement du conducteur, de sa fureur et du déluge de Dieu. Nous sommes arrivée·es avec une heure de retard et la salle comble avait attendu. L’acoustique de la pièce était superbe, ce qui a amélioré non seulement ma propre voix, mais aussi les hurlements sans fin de mon chien, qui a finalement fendu la foule pour venir s’asseoir sur scène pendant la période des questions. Le public était fabuleux : impliqué, sérieux, stimulant. Bon nombre des idées du discours étaient nouvelles et enrageantes, parce qu’elles affrontaient frontalement la nature politique de la sexualité masculine. La femme chez qui nous devions rester et qui était responsable de notre voyage de retour était tellement en furie qu’elle s’enfuit de la pièce pour ne jamais revenir. Nous étions en rade, sans argent, sans savoir où nous adresser. Une personne seule peut se retrouver en rade et s’en sortir, même si elle sera en danger ; deux personnes avec un berger allemand et sans argent sont vraiment dans le pétrin. Finalement, une femme que je connaissais à peine nous a accueilli·es et nous a prêté l’argent pour rentrer. Travailler (et c’est un travail exigeant, intense, difficile) et voyager dans de telles conditions sans cesse improvisées nécessite de développer une affection pour la comédie de situation et le mélodrame grossier. Je n’y suis jamais arrivée. Au lieu de cela je devins fatiguée et démoralisée. Et encore plus pauvre, parce que jamais quiconque n’avait les moyens de me payer le temps qu’il fallait pour écrire. Ce n’est qu’après la publication de Notre sang que j’ai commencé à exiger des honoraires réalistes, des hébergements fiables et des déplacements sûrs en échange de mon travail. J’avais essayé par intermittence et surtout échoué. Or maintenant je devais être payée et en sécurité. Je sentais que j’étais vraiment entrée dans l’âge adulte. Cela présentait de nouvelles difficultés pour les organisatrices féministes qui n’avaient guère accès aux ressources matérielles de leur communauté. Cela présentait aussi pour moi de nouvelles difficultés. Pendant longtemps, on ne m’a offert aucun travail, ce qui fait que je devins de plus en plus pauvre. Cela n’avait de sens pour personne d’autre que moi : si vous n’avez rien et que quelqu’un vous offre quelque chose, comment pouvez-vous le refuser ? Mais je l’ai fait, parce que je savais que je ne gagnerais jamais ma vie autrement qu’en me tenant debout. J’avais une belle et croissante réputation de conférencière et d’écrivaine ; mais encore et toujours, il n’y avait pas d’argent pour moi. Quand j’ai commencé à demander des honoraires, j’ai reçu de certaines femmes des réponses colériques : comment l’autrice de La haine des femmes pouvait-elle être une capitaliste aussi écœurante, m’a demandé une femme dans une lettre quasi obscène. L’autrice de la lettre voulait aller vivre dans une ferme et n’avoir rien à faire avec des merdes capitalistes et des féministes bourgeoises. Eh bien ! lui ai-je répondu, je ne vivais pas dans une ferme et ne voulais pas le faire ; j’achetais ma nourriture dans un supermarché et je payais un loyer à un propriétaire et je voulais écrire des livres. Je répondais à toutes les lettres irritées. J’essayais d’expliquer les politiques d’accès à l’argent, surtout dans les lycées et les universités : l’argent était là ; c’était difficile d’y accéder ; pourquoi devrait-il aller à Phyllis Schlafly ou William F. Buckley Jr. ? Je devais vivre et je devais écrire. Sûr que mes écrits leur importaient, ils comptaient pour elles, autrement pourquoi voulaient-elles de moi : et voulaient-elles que je cesse d’écrire ? J’avais besoin d’argent pour écrire. J’avais effectué des travaux pourris et je vivais dans une pauvreté réelle, pas du tout bucolique. J’ai trouvé que l’effort d’expliquer a vraiment aidé – pas toujours, et les ressentiments font encore surface, mais assez pour me faire croire qu’expliquer même sans finalement convaincre en valait la peine. Même si je n’étais pas payée, quelqu’un d’autre le serait un jour. Après une longue période de jachère, j’ai recommencé à donner des conférences. Je le faisais de temps à autre et jamais suffisamment pour en vivre, dans ce que je considère comme une pauvreté stable, même lorsque mes honoraires étaient élevés. Beaucoup de militantes féministes se sont battues pour obtenir de l’argent et ont parfois réussi. Alors j’ai tenu bon – des amies m’ont prêté de l’argent, parfois des dons anonymes arrivaient par la poste, des femmes me remettaient des chèques pendant des conférences et refusaient de me laisser les repousser, des écrivaines féministes me faisaient don d’argent et m’en prêtaient, et des femmes menaient des batailles incroyables et acharnées avec des administrateur·trices de lycées et des comités et des facultés pour me faire embaucher et payer. Le mouvement des femmes m’a gardé en vie. Je ne vivais pas bien, en sécurité ou facilement, mais je n’ai pas arrêté d’écrire non plus. Je reste extrêmement reconnaissante aux personnes qui ont assuré mes arrières à cette époque.
J’ai décidé de publier les discours de Notre sang parce que j’avais désespérément besoin d’argent, l’accès aux magazines continuait à m’être refusé, et je vivais au jour le jour sur la route. Publier un livre était ma seule chance.
L’éditrice chargée de collection qui a décidé de publier Notre sang n’appréciait pas particulièrement ma politique, mais elle aimait ma prose. J’étais heureuse d’être reconnue en tant qu’écrivaine. Cette maison d’édition était la seule de New York dotée d’un syndicat et elle avait aussi un caucus dynamique de femmes. Les employées étaient unanimement merveilleuses envers moi – concernées par le féminisme de façon vitale, touchées par mon travail, conscientes et gentilles. Elles m’ont invitée à intervenir auprès du personnel de l’entreprise lors de leur journée biennale des femmes, peu de temps avant la publication de Notre sang. J’ai traité de la présomption systématique d’appropriation masculine du corps et du travail des femmes, la réalité matérielle de cette possession, la dévalorisation économique du travail des femmes. (Ce discours a ensuite été publié en forme abrégée sous le titre « L’impérialisme phallique » dans Ms., en décembre 1976.) Quelques cravatés y assistèrent sombrement, prenant des notes du début à la fin. Inutile de préciser que ce fut la fin de Notre sang. Il y eut un autre événement marquant : un chef de service haut placé jeta à travers la pièce le manuscrit de Notre sang à la figure de mon éditrice. Je n’y ai pas reconnu la tendresse masculine, a-t-il dit. Je ne sais pas s’il l’a dit avant ou après avoir lancé le manuscrit.
Notre sang a été publié en édition reliée en 1976. Le seul compte-rendu à son propos à paraître dans un grand périodique l’a été dans le magazine Ms., plusieurs mois après son arrivée en librairies. C’était un éloge. Sinon, le livre a été ignoré délibérément, avec malveillance. Gloria Steinem, Robin Morgan et Karen DeCrow ont tenté en vain de faire publier des comptes-rendus. J’ai contacté près d’une centaine d’écrivaines, de militantes, d’éditrices féministes. Une grande majorité a fait d’innombrables efforts pour que paraissent des articles sur le livre. Certaines ont réussi à faire publier des recensions dans des publications féministes, mais même celles qui publiaient fréquemment ailleurs ont été incapables d’y parvenir dans la grande presse. Personne n’a réussi à rompre le silence général. Puis, Notre sang a été envoyé à presque toutes les maisons d’édition de livres brochés aux États-Unis, parfois plus d’une fois, sur une période de plusieurs années. Personne n’acceptait de rééditer ce titre. C’est donc avec une grande joie et un sentiment précaire de victoire que je salue sa publication dans cette édition. J’éprouve un amour particulier pour ce livre. La plupart des féministes que je connais qui ont lu Notre sang m’ont prise à part à un moment ou à un autre pour me dire qu’elles avaient une affection et un respect particuliers pour lui. Je crois qu’il représente quelque chose de vraiment beau et particulier. C’est peut-être parce qu’il a été écrit pour une voix humaine. C’est peut-être parce que j’ai dû me battre si fort pour dire ce qu’il contient. C’est peut-être parce que Notre sang a directement touché la vie de tant de femmes : ces paroles ont été dites encore et encore à de vraies femmes et l’expérience de dire les mots a consolidé leur écriture. La haine des femmes a été écrit par une écrivaine plus jeune, ayant plus de témérité et d’espoir. Ce livre est plus discipliné, plus sombre, plus rigoureux, et à certains égards plus passionné. Je suis heureuse qu’il atteigne maintenant un public plus large, et désolée que cela ait pris tant de temps.
Andrea Dworkin
New York, mars 1981
[1] On m’avait mis en garde très tôt à propos de ce que signifiait être une fille, mais je n’avais pas écouté. « Vous écrivez comme un homme », m’a écrit un éditeur en lisant le brouillon des premiers chapitres de La haine des femmes. « Quand vous apprendrez à écrire comme une femme, nous envisagerons de vous publier. » Cet avertissement m’a rappelé un conseiller d’orientation au lycée qui me demandait, alors que l’heure du diplôme approchait, ce que j’avais prévu d’être quand je serai grande. Écrivaine, j’ai répondu. Il baissa les yeux, puis me regarda sobrement. Il savait que je voulais aller dans un superbe collège ; il savait que j’étais ambitieuse. « Ce que tu dois faire », dit-il : « c’est aller dans un collège public – il n’y a aucune raison pour que tu ailles ailleurs – et deviens enseignante pour pouvoir te retourner quand ton mari mourra. » Cette histoire n’est pas apocryphe. Elle m’est arrivée à moi et à d’innombrables autres. J’avais considéré les propos à la fois du conseiller et de l’éditeur stupides, individuellement stupides. J’avais tort. Ils n’étaient pas individuellement stupides.
[2] « Renoncer à l’égalité sexuelle » a été écrit pour la conférence de la National Organization for Women sur la sexualité qui a eu lieu à New York le 12 octobre 1974.
[3] Après la publication de Notre sang, je me suis rendu à ce même hebdomadaire pour quémander – oui, quémander – un peu d’attention à propos du livre, qui était en train de mourir. L’écrivain dont la « libération » avait été menacée par « Renoncer à “l’égalité sexuelle” » a demandé à me rencontrer. Il m’a dit, encore et encore, à quel point Notre sang était beau. « Vous savez… euh…, dis-je, que… euh, euh… le discours est dans Notre sang – vous savez, celui sur lequel vous avez écrit. » « Tellement beau », dit-il, « tellement beau ». Le rédacteur en chef de l’hebdomadaire m’a écrit que Notre sang était si beau, si émouvant… Mais Notre sang n’a obtenu aucune aide, ni même une mention, dans les pages de l’hebdomadaire.
Andrea Dworkin : Notre Sang
Prédictions et discours sur la politique sexuelle
Traduction de l’anglais (Etats-Unis) par Yeun Lagadeuc-Ygouf et Marti Dufresne
Relecture de Christine Delphy
M éditeur, Saint-Joseph-du-Lac (Québec) 2021, 176 pages
http://m-editeur.info/notre-sang-predictions-et-discours-sur-la-politique-sexuelle/
